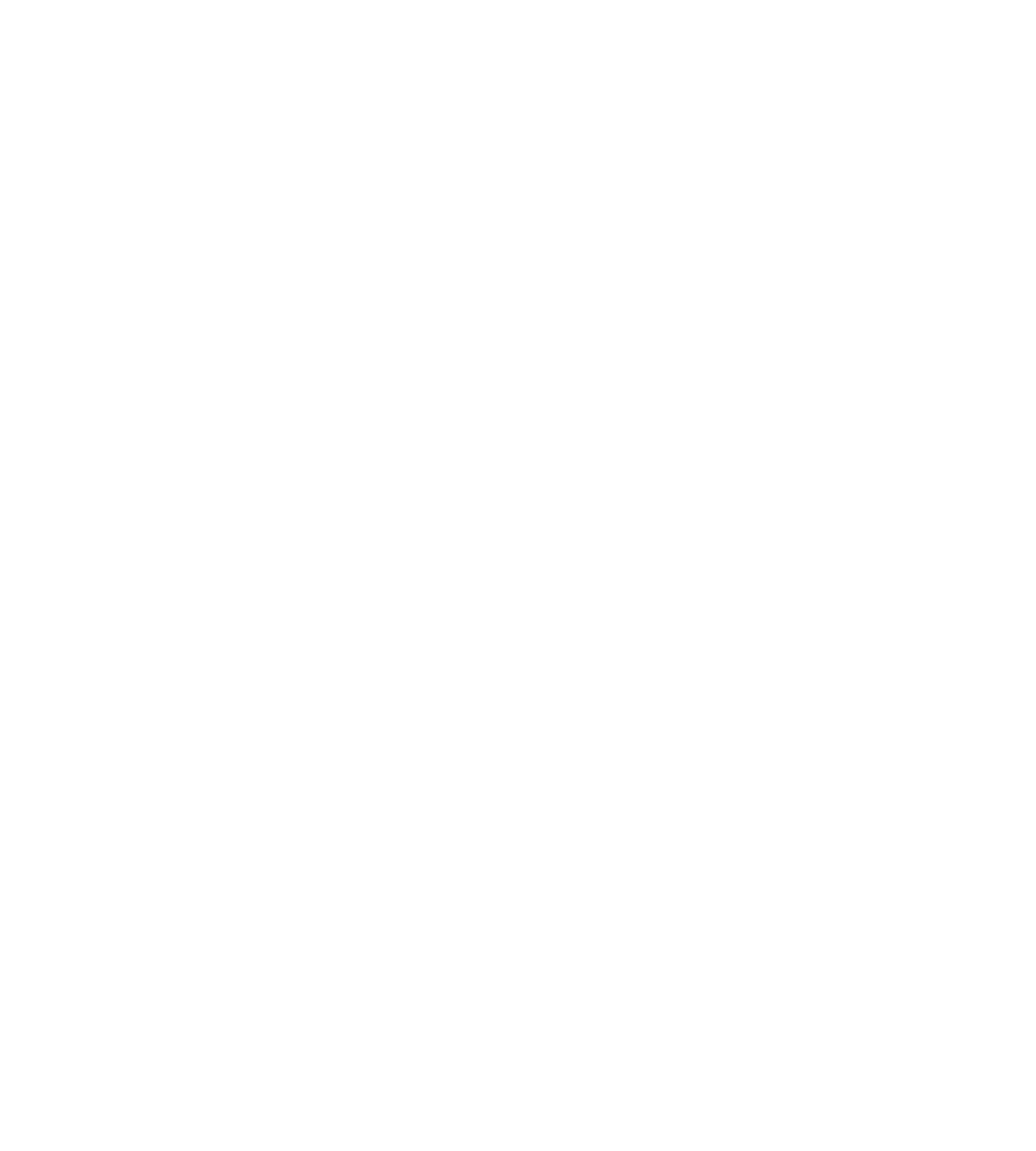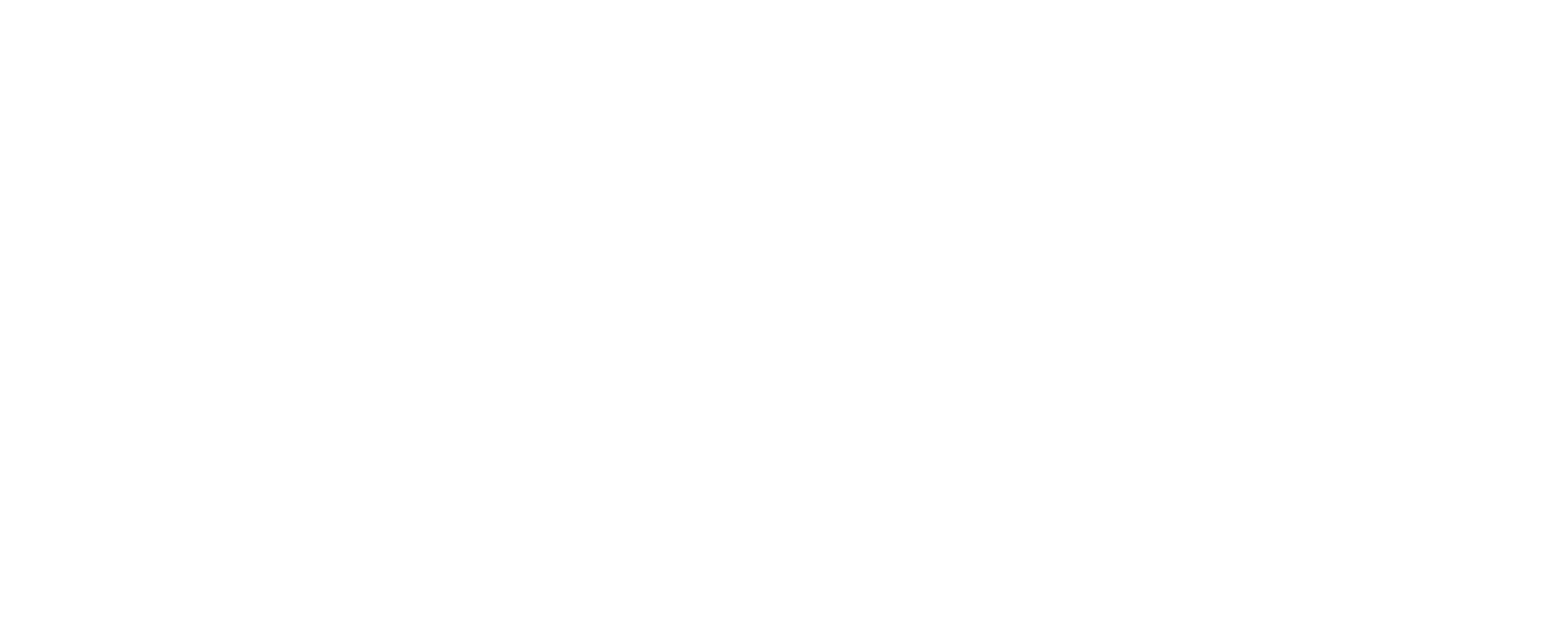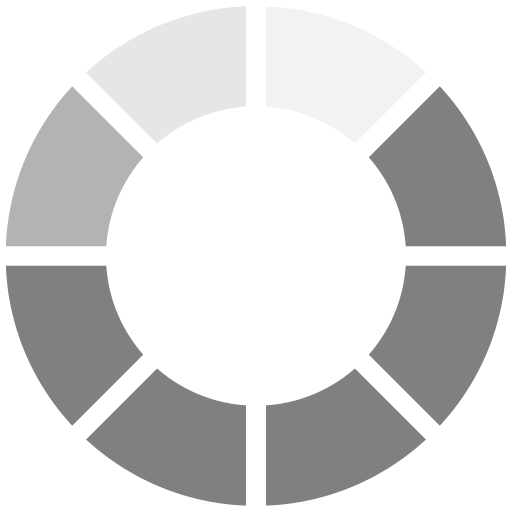« Assortiment ou césure : deux modalités de la relation entre l’œuvre et son décor » - Conférence de Thierry Leviez
13 Oct 2021
Dans le cadre de l'enseignement et du cycle de conférences « L'entour. Histoire et technique de la scénographie d'exposition » co-organisé par l'ENSA Paris-Malaquais, les Beaux-Arts de Paris et le Pavillon Bosio de Monaco.
Mercredi 13 octobre
à 10h00
En présentiel, amphithéâtre d’honneur, école des Beaux-Arts de Paris, 14 rue Bonaparte, Paris 6e
En distanciel, conférence diffusée en direct via l’application Zoom :
lien de diffusion
ID de réunion : 831 7963 9983
Code : 148717
Parmi les usages de l’exposition contemporaine, l’un des plus solidement ancré consiste à assortir le décor à l’œuvre et procède de l’idée sous-jacente qu’il n’existe qu’en tant qu’élément passif. Ces environnements mimétiques ont traversé l’histoire de l’art, qu’on pense, pour prendre trois échelles distinctes, aux cadres baroques, aux dioramas et aux period rooms. Mais la généralisation de ces assortiments est un phénomène récent. Jusqu’aux premières expositions des impressionnistes, l’usage consiste au contraire à opérer une séparation entre l’œuvre, “fenêtre sur le monde”, et ce qui l’entoure. Au début du 19e siècle, la pratique de l’assortiment est d’abord initiée, à l’échelle du cadre, par des groupes d’artistes dissidents, en rupture avec les règles de l’Académie. Whistler sera le premier à appliquer le même procédé à l’espace scénographique, influençant durablement la pratique de l’exposition. Ces jeux de correspondances, traduits, pendant la première moitié du 20e siècle dans les recherches des avant-gardes, vont se dissoudre après-guerre. La généralisation de principes modernistes appliqués universellement à tous types d’objets va instaurer une logique inverse fondée sur des effets de contraste. Pendant plusieurs décennies, chapiteaux romans, sculptures Renaissance ou paysages flamands seront traités à la même enseigne, enlevés à leur contexte d’origine et “renaturés” sur le fond uniforme de l’esthétique moderne.
> En savoir plus sur l’enseignement « L’entour. Histoire et technique de la scénographie d’exposition » :
Mercredi 13 octobre
à 10h00
En présentiel, amphithéâtre d’honneur, école des Beaux-Arts de Paris, 14 rue Bonaparte, Paris 6e
En distanciel, conférence diffusée en direct via l’application Zoom :
lien de diffusion
ID de réunion : 831 7963 9983
Code : 148717
Parmi les usages de l’exposition contemporaine, l’un des plus solidement ancré consiste à assortir le décor à l’œuvre et procède de l’idée sous-jacente qu’il n’existe qu’en tant qu’élément passif. Ces environnements mimétiques ont traversé l’histoire de l’art, qu’on pense, pour prendre trois échelles distinctes, aux cadres baroques, aux dioramas et aux period rooms. Mais la généralisation de ces assortiments est un phénomène récent. Jusqu’aux premières expositions des impressionnistes, l’usage consiste au contraire à opérer une séparation entre l’œuvre, “fenêtre sur le monde”, et ce qui l’entoure. Au début du 19e siècle, la pratique de l’assortiment est d’abord initiée, à l’échelle du cadre, par des groupes d’artistes dissidents, en rupture avec les règles de l’Académie. Whistler sera le premier à appliquer le même procédé à l’espace scénographique, influençant durablement la pratique de l’exposition. Ces jeux de correspondances, traduits, pendant la première moitié du 20e siècle dans les recherches des avant-gardes, vont se dissoudre après-guerre. La généralisation de principes modernistes appliqués universellement à tous types d’objets va instaurer une logique inverse fondée sur des effets de contraste. Pendant plusieurs décennies, chapiteaux romans, sculptures Renaissance ou paysages flamands seront traités à la même enseigne, enlevés à leur contexte d’origine et “renaturés” sur le fond uniforme de l’esthétique moderne.
> En savoir plus sur l’enseignement « L’entour. Histoire et technique de la scénographie d’exposition » :