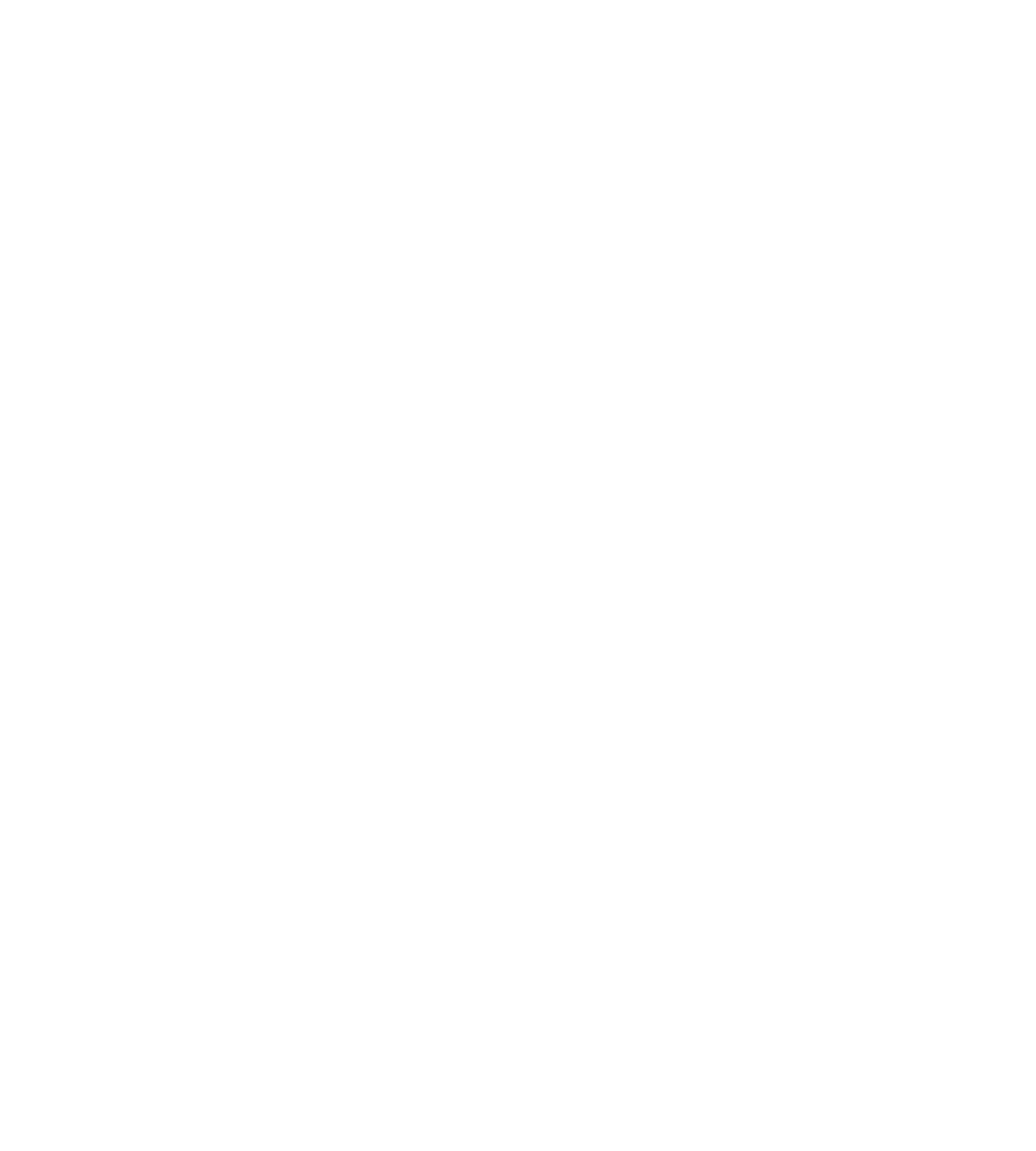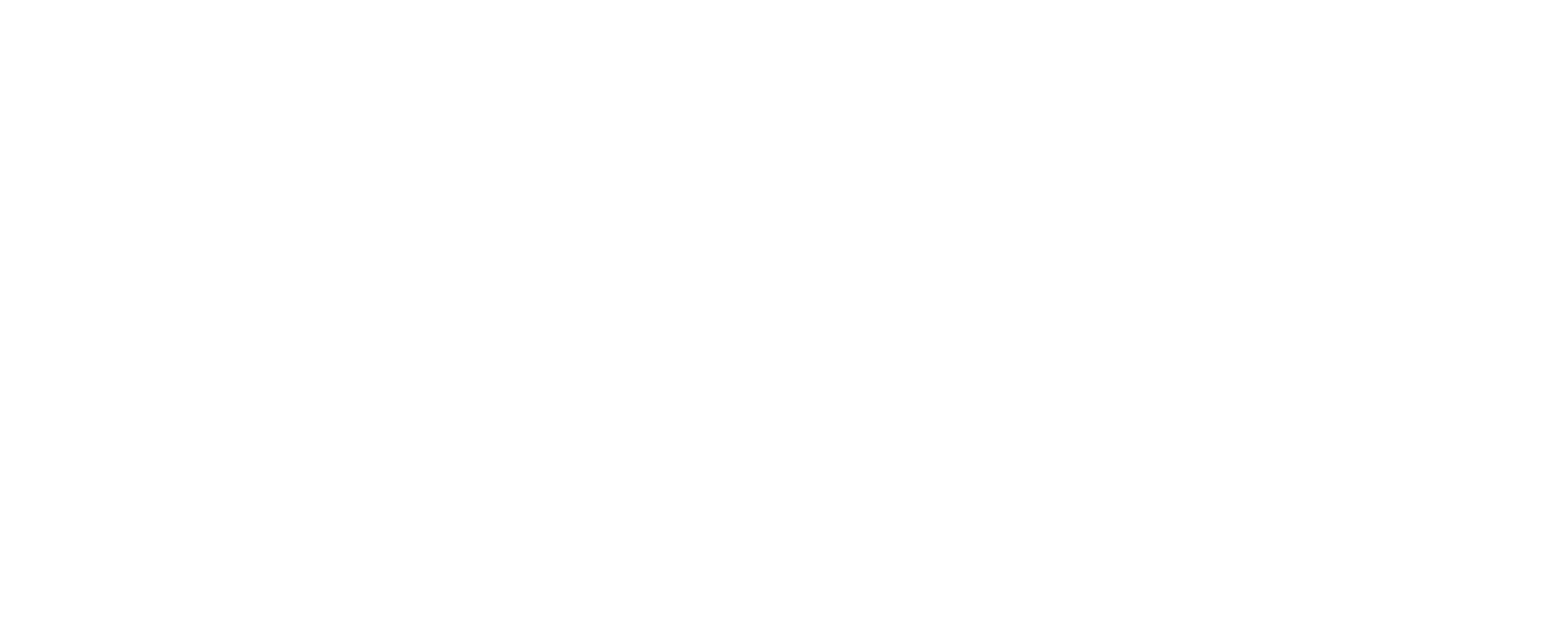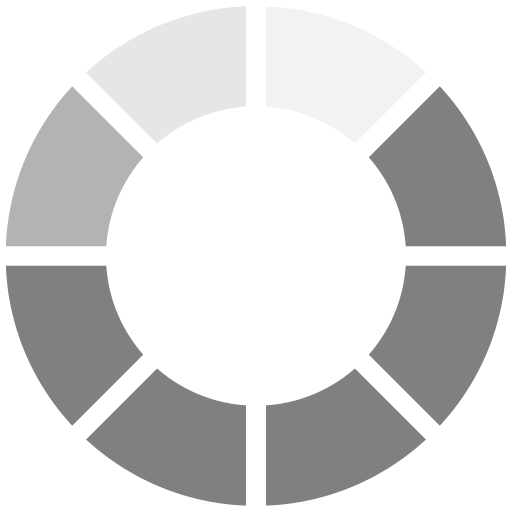"Biomimétisme des stratégies" - Jacques Haiech
27 Nov 2025
Dans le cadre du séminaire de recherche du département DM (Digital Matters)
Jeudi 27 novembre 2025
9h-12h
- 9h30 – 10h15 : conférence de Jacques Haiech
- 10h30 – 12h00 : discussion ouverte / débat / table ronde
École d’architecture Paris-Malaquais
1 rue Jacques Callot (4e étage) – Paris VIe
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Le séminaire de master du département DM (Digital Matters) organise une journée d’étude autour du biomimétisme et invite Jacques Haiech, professeur honoraire de l’Université de Strasbourg.
« Biomimétisme des stratégies : une perspective PRC (Persistance–Résilience–Compétition) pour penser l’architecture comme un système vivant »
Jacques Haiech
Le biomimétisme en architecture, s’il a le vent en poupe, reste souvent confiné à une imitation formelle ou structurelle du vivant. Cette approche, bien que féconde, fait l’économie d’un dialogue avec les principes fondamentaux qui régissent l’évolution et la pérennité des systèmes biologiques. L’ambition de cette intervention est de dépasser ce stade pour proposer un cadre théorique robuste permettant de concevoir l’architecture non pas en copiant la vie, mais en pensant comme elle.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur le cadre conceptuel développé dans notre article « Évolution des systèmes vivants : une perspective PRC ».
Ce modèle postule que la dynamique de tout système vivant, de la cellule à l’écosystème, peut être appréhendée à travers trois fonctions interdépendantes et universelles :
- La persistance : la capacité d’un système à maintenir son organisation et son intégrité dans le temps, en luttant activement contre l’entropie.
- La résilience : la capacité à absorber les perturbations et à se réorganiser pour s’adapter à des contraintes nouvelles, souvent par des phénomènes d’émergence.
- La compétition : le processus de sélection qui favorise les stratégies et les formes les plus efficientes pour l’accès aux ressources (énergie, information, espace).
L’intervention transposera cette grille de lecture au champ de l’architecture et de l’urbanisme. Nous analyserons l’environnement bâti non plus comme un ensemble d’objets inertes, mais comme un système dynamique complexe, un quasi-écosystème.
La persistance d’un édifice sera ainsi reliée à sa lutte contre l’entropie physique et informationnelle, engageant une réflexion sur la durabilité réelle des matériaux et des structures. La résilience d’un tissu urbain sera examinée à travers les phénomènes d’émergence et d’auto-organisation, qui génèrent des patterns adaptatifs (tels que la mixité fonctionnelle ou les réseaux de mobilité douce), bien plus robustes que les schémas rigides issus de la seule planification. Enfin, la compétition permettra de modéliser l’évolution des typologies architecturales comme une véritable morphogenèse culturelle et technique, soumise à des pressions de sélection (économiques, climatiques, sociales).
L’objectif final est de proposer un changement de paradigme : passer d’un biomimétisme de la forme à un biomimétisme des stratégies. Il s’agit de fournir aux architectes un modèle conceptuel pour penser la conception non plus comme la création d’un objet fini, mais comme l’initiation de processus évolutifs. Cette perspective vise à redéfinir le rôle de l’architecte, non plus comme un démiurge, mais comme un « ingénieur en systémique du vivant », dont la mission est de concevoir des environnements bâtis dotés d’une capacité intrinsèque de persistance et d’adaptation.
Jacques Haïech, Professeur honoraire Unistra
Le parcours de Jacques Haiech débute en 1973 à l’ENS Paris-Saclay dans la section mathématiques/informatique. Il élargit ensuite son domaine d’expertise en se rendant à Montpellier pour suivre un cursus en biologie, qui le conduit à réaliser une thèse en biologie suivie par un stage postdoctoral à Oxford (Angleterre) et en France.
Ces travaux posent les fondements de ses recherches futures sur le signal calcique intracellulaire et ses modulations. Après avoir été recruté par le CNRS Jacques Haiech fonde son équipe au CRBM, à Montpellier afin de comprendre le signal calcium depuis les protéines jusqu’aux organes, tout en intégrant les premiers outils d’intelligence artificielle.
En 1987, Jacques Haiech se rend à Marseille pour piloter la plateforme nationale de production de bactéries et de protéines recombinantes et pour la mise en place d’une plateforme automatisée de séquençage, participant ainsi au projet européen de séquençage de Bacillus subtilis.
En 1997, il intègre la faculté de Pharmacie à Strasbourg et participe à la mise en place de la première plateforme nationale de criblage et de la première collection de molécules chimiques issues des laboratoires académiques (ChemBiochem). Parallèlement, Jacques Haiech s’implique dans l’administration scientifique, avant de se consacrer à l’enseignement de l’intégrité scientifique à l’Université Paris-Cité, à partir de son départ à la retraite en 2018.
Le séminaire DM est organisé et animé en ce premier semestre de façon collégiale par Nicolas Le Duc, Emmanuelle Chiaponne-Piriou, Emilien Cristia, Anahita Mirani et Lazaros Mavromatidis.
Jeudi 27 novembre 2025
9h-12h
- 9h30 – 10h15 : conférence de Jacques Haiech
- 10h30 – 12h00 : discussion ouverte / débat / table ronde
École d’architecture Paris-Malaquais
1 rue Jacques Callot (4e étage) – Paris VIe
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Le séminaire de master du département DM (Digital Matters) organise une journée d’étude autour du biomimétisme et invite Jacques Haiech, professeur honoraire de l’Université de Strasbourg.
« Biomimétisme des stratégies : une perspective PRC (Persistance–Résilience–Compétition) pour penser l’architecture comme un système vivant »
Jacques Haiech
Le biomimétisme en architecture, s’il a le vent en poupe, reste souvent confiné à une imitation formelle ou structurelle du vivant. Cette approche, bien que féconde, fait l’économie d’un dialogue avec les principes fondamentaux qui régissent l’évolution et la pérennité des systèmes biologiques. L’ambition de cette intervention est de dépasser ce stade pour proposer un cadre théorique robuste permettant de concevoir l’architecture non pas en copiant la vie, mais en pensant comme elle.
Pour ce faire, nous nous appuierons sur le cadre conceptuel développé dans notre article « Évolution des systèmes vivants : une perspective PRC ».
Ce modèle postule que la dynamique de tout système vivant, de la cellule à l’écosystème, peut être appréhendée à travers trois fonctions interdépendantes et universelles :
- La persistance : la capacité d’un système à maintenir son organisation et son intégrité dans le temps, en luttant activement contre l’entropie.
- La résilience : la capacité à absorber les perturbations et à se réorganiser pour s’adapter à des contraintes nouvelles, souvent par des phénomènes d’émergence.
- La compétition : le processus de sélection qui favorise les stratégies et les formes les plus efficientes pour l’accès aux ressources (énergie, information, espace).
L’intervention transposera cette grille de lecture au champ de l’architecture et de l’urbanisme. Nous analyserons l’environnement bâti non plus comme un ensemble d’objets inertes, mais comme un système dynamique complexe, un quasi-écosystème.
La persistance d’un édifice sera ainsi reliée à sa lutte contre l’entropie physique et informationnelle, engageant une réflexion sur la durabilité réelle des matériaux et des structures. La résilience d’un tissu urbain sera examinée à travers les phénomènes d’émergence et d’auto-organisation, qui génèrent des patterns adaptatifs (tels que la mixité fonctionnelle ou les réseaux de mobilité douce), bien plus robustes que les schémas rigides issus de la seule planification. Enfin, la compétition permettra de modéliser l’évolution des typologies architecturales comme une véritable morphogenèse culturelle et technique, soumise à des pressions de sélection (économiques, climatiques, sociales).
L’objectif final est de proposer un changement de paradigme : passer d’un biomimétisme de la forme à un biomimétisme des stratégies. Il s’agit de fournir aux architectes un modèle conceptuel pour penser la conception non plus comme la création d’un objet fini, mais comme l’initiation de processus évolutifs. Cette perspective vise à redéfinir le rôle de l’architecte, non plus comme un démiurge, mais comme un « ingénieur en systémique du vivant », dont la mission est de concevoir des environnements bâtis dotés d’une capacité intrinsèque de persistance et d’adaptation.
Jacques Haïech, Professeur honoraire Unistra
Le parcours de Jacques Haiech débute en 1973 à l’ENS Paris-Saclay dans la section mathématiques/informatique. Il élargit ensuite son domaine d’expertise en se rendant à Montpellier pour suivre un cursus en biologie, qui le conduit à réaliser une thèse en biologie suivie par un stage postdoctoral à Oxford (Angleterre) et en France.
Ces travaux posent les fondements de ses recherches futures sur le signal calcique intracellulaire et ses modulations. Après avoir été recruté par le CNRS Jacques Haiech fonde son équipe au CRBM, à Montpellier afin de comprendre le signal calcium depuis les protéines jusqu’aux organes, tout en intégrant les premiers outils d’intelligence artificielle.
En 1987, Jacques Haiech se rend à Marseille pour piloter la plateforme nationale de production de bactéries et de protéines recombinantes et pour la mise en place d’une plateforme automatisée de séquençage, participant ainsi au projet européen de séquençage de Bacillus subtilis.
En 1997, il intègre la faculté de Pharmacie à Strasbourg et participe à la mise en place de la première plateforme nationale de criblage et de la première collection de molécules chimiques issues des laboratoires académiques (ChemBiochem). Parallèlement, Jacques Haiech s’implique dans l’administration scientifique, avant de se consacrer à l’enseignement de l’intégrité scientifique à l’Université Paris-Cité, à partir de son départ à la retraite en 2018.
Le séminaire DM est organisé et animé en ce premier semestre de façon collégiale par Nicolas Le Duc, Emmanuelle Chiaponne-Piriou, Emilien Cristia, Anahita Mirani et Lazaros Mavromatidis.