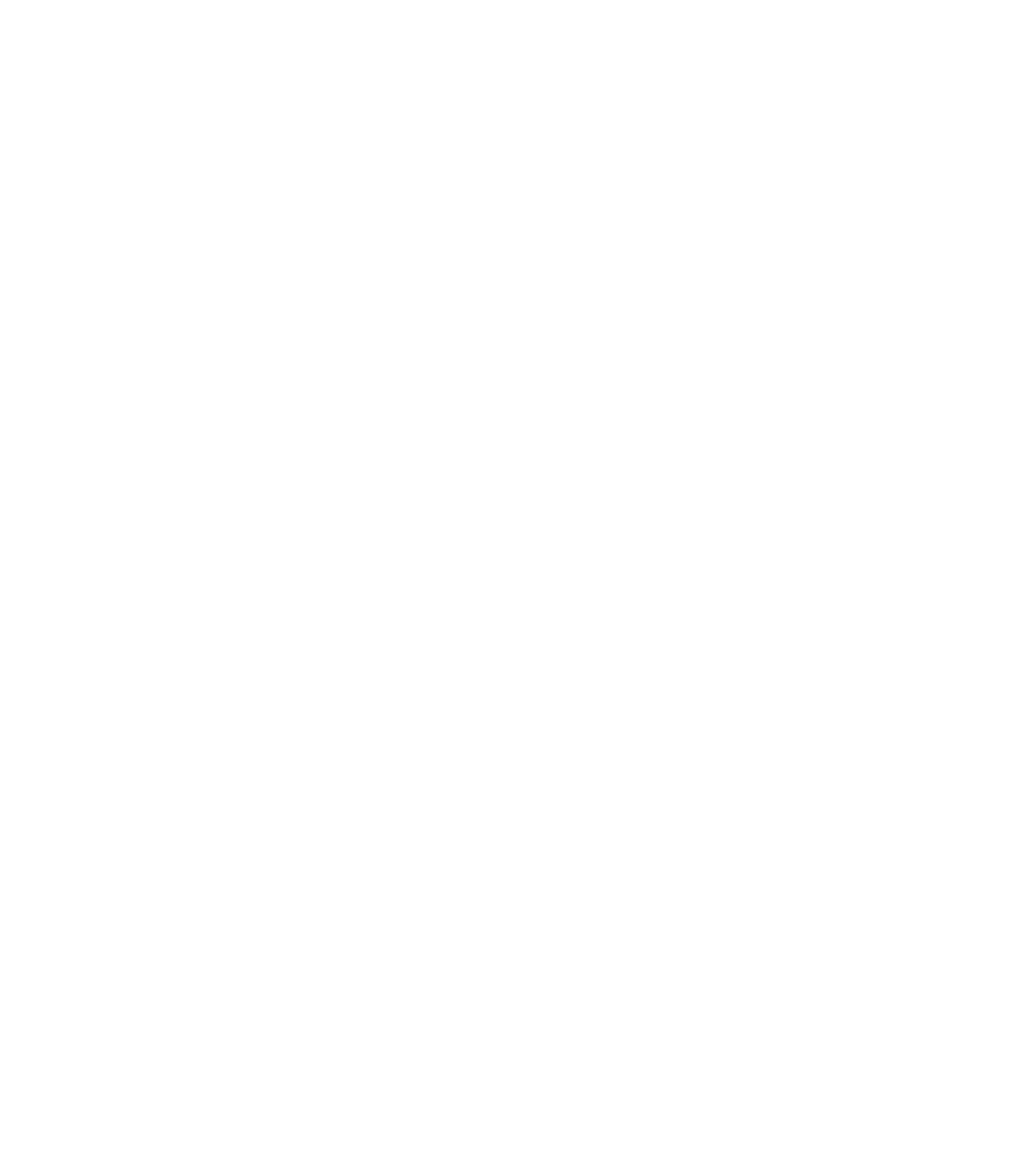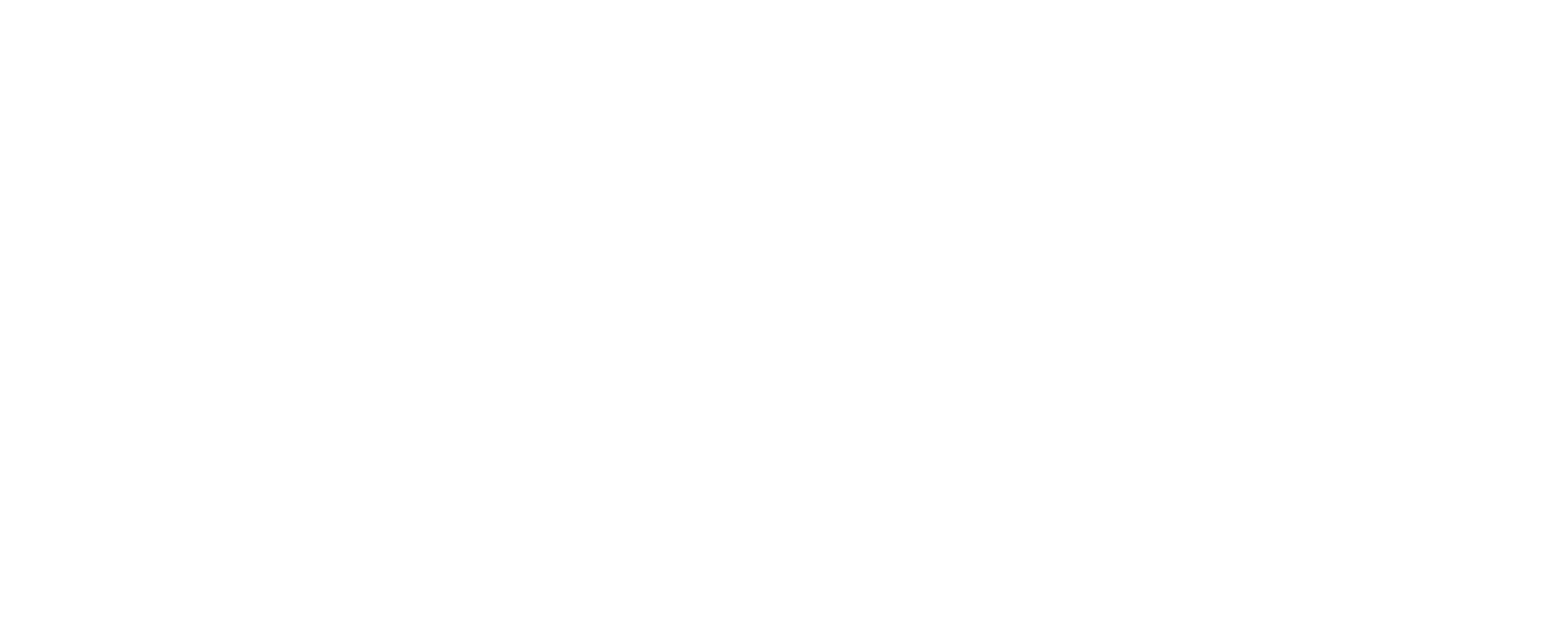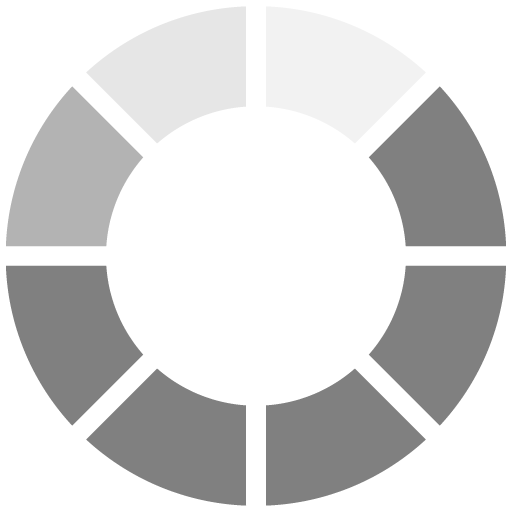sous la direction de Dominique Rouillard
Université Paris-Est, ED Ville, Transport et Territoire
Soutenue le 14 décembre 2023 à l’ENSA Paris-Malaquais
Au cours des années 1960, une série de logements sociaux expérimentaux sont construits en Italie. Réunissant toutes les fonctions d’une ville en un seul objet architectural, ces complexes formulent une alternative critique aux modèles de logement adoptés dans l’après-guerre. En Italie, leur posture critique se dresse en particulier contre la « politique du quartier » héritée de l’unité de voisinage, et dont l’idéologie villageoise est alors jugée anachronique, voire réactionnaire. En réaction au « quartier », les expériences mégastructurales cherchent à restituer ce qui a pu être qualifié d’effetto-città («effet-ville»). Il s’agit de reproduire le dynamisme, la permissivité et les vertus émancipatrices de la grande ville, tout en favorisant le lien social, perdu par le fonctionnalisme, d’une communauté d’habitants. A l’appui de 4 projets réalisés en près de 15 années d’écart (Sorgane, G.Michelucci puis L. Ricci, L. Savioli et F. Poggi, à Florence, 1956-1966 ; Rozzol Melara, à Trieste, de C. et L. Celli, D. Tognon, 1968-1981 ; Vigne Nuove à Rome, de L. Passarelli et A. Lambertucci, 1971-1979 ; Le Vele, Naples, F. di Salvo, 1968-1980), la thèse vise d’une part à analyser le modèle idéologique incarné par ces projets et le mode de vie qu’ils encouragent, d’autre part à interroger leur permanence à l’épreuve des usages. Dans cette perspective, elle met en regard trois récits : le récit politique, le récit architectural, et celui des habitants.
Cette thèse a été financée par un contrat doctoral 2018-2020 du Bureau de la Recherche Architecturale et Paysagère (BRAUP) du Ministère de la Culture et de la Communication