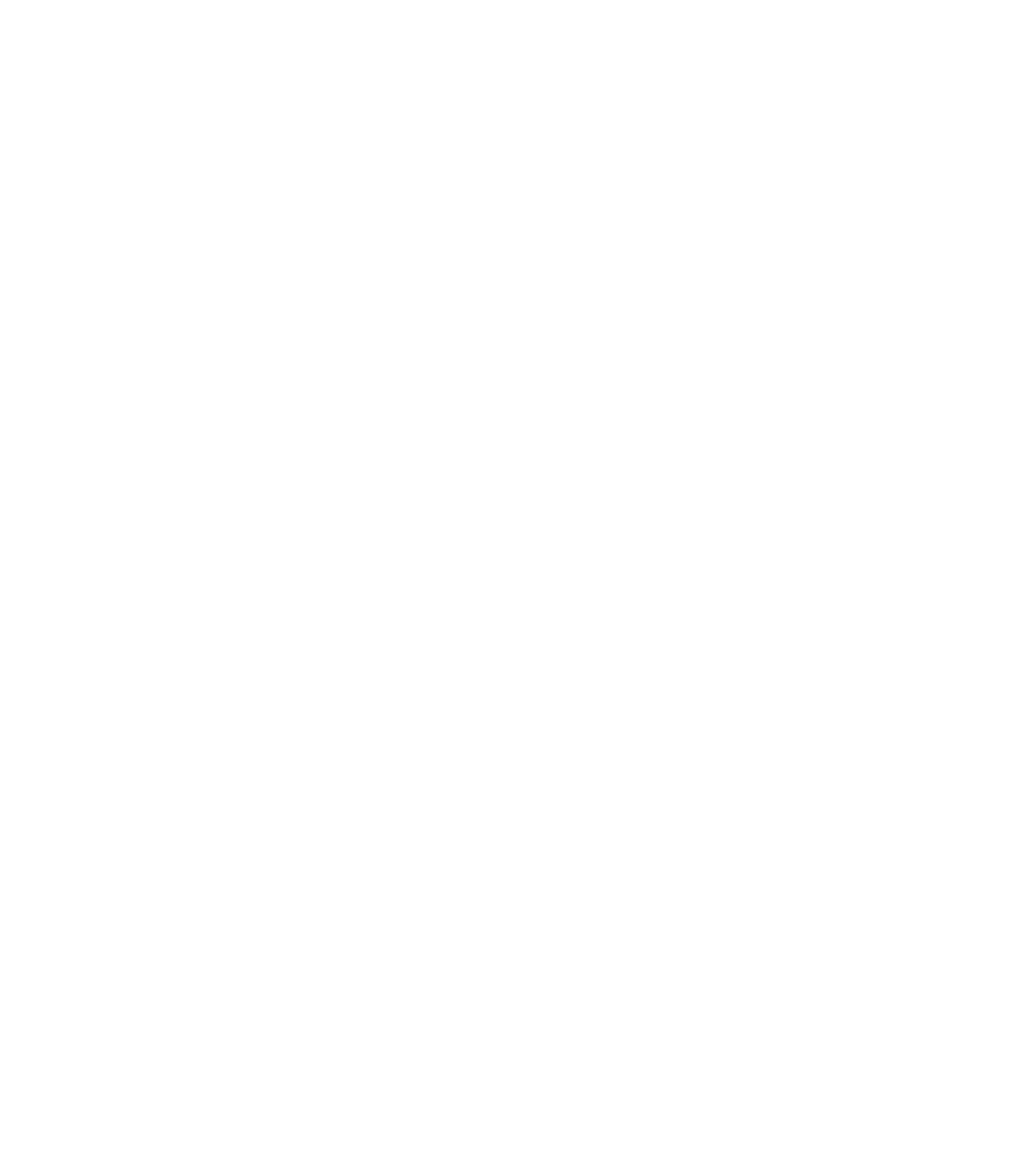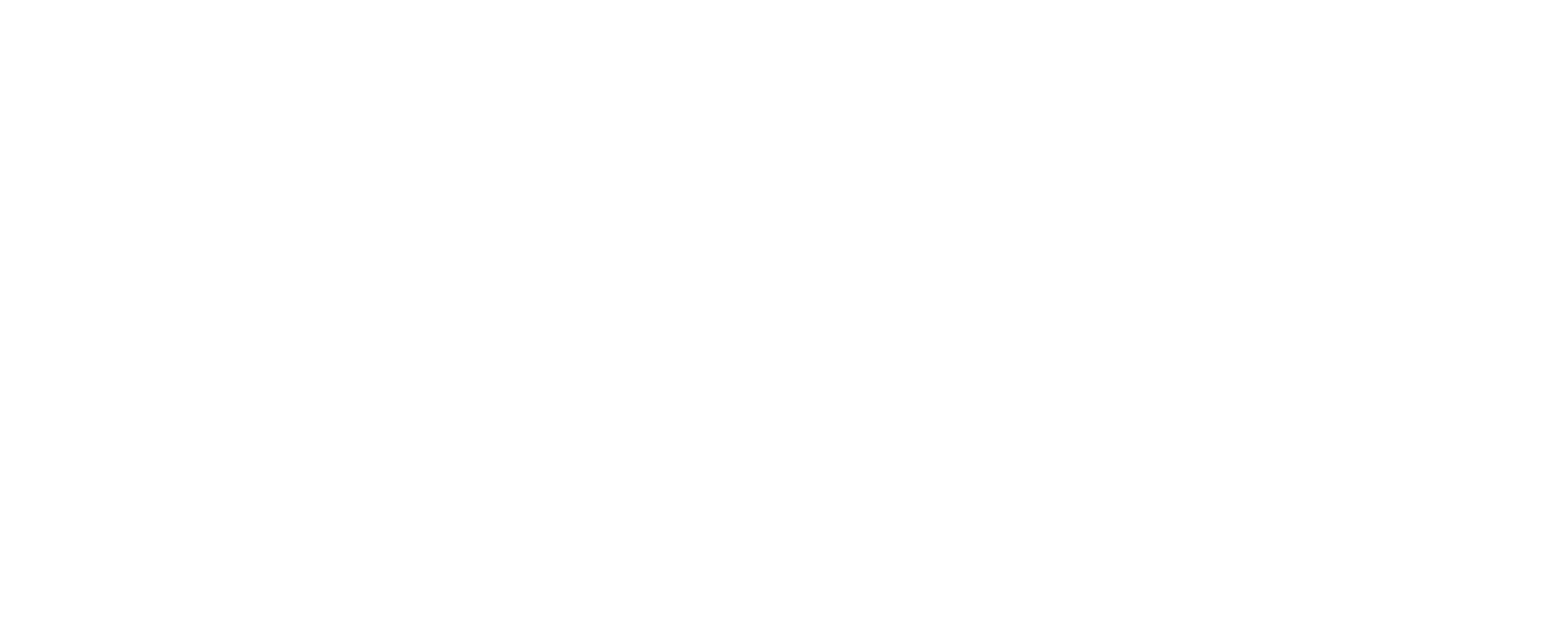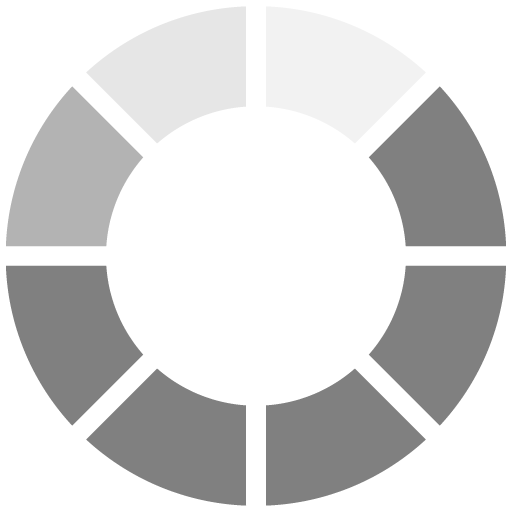Publications LIAT
Magie. La déraison des infrastructures
Auteur(s) : Dominique Rouillard et Marie ARTUPHEL
Métispresse Genève
Dans les objets qu'elle incarne comme dans les discours et les imaginaires qu'elle produit, l'infrastructure tire sa légitimité d'une rhétorique fondée sur la toute-puissance de la raison. Mais qu'advient-il de l'infrastructure lorsqu'elle se voit déplacée dans un champ qui lui serait en principe étranger, celui de la « magie » : du fantastique au merveilleux, de la superstition au sacré, de l'illusion à l'enchantement? En explorant la rencontre inattendue de l'irrationnel et de l'infrastructure à travers différents objets - montagnes russes, installations minières, autoroutes ou encore cinéma atmosphérique - ou en reparcourant la théorie de l'architecture à la lumière de ces notions a priori antinomiques, Magie démontre que l'infrastructure engendre aussi des projets qui échappent à ses raisons. Au travers de ses contributions, cet ouvrage propose une nouvelle lecture de l'imaginaire et de la portée symbolique de l'infrastructure. Publié sous la direction scientifique de Dominique Rouillard et Marie Artuphel, avec les contributions des chercheuses et chercheurs du Laboratoire Infrastructure, Architecture, Territoire (LIAT): Marie Artuphel, Carlotta Darò, Gilles Delalex, Marion Emery, Alain Guiheux, Renzo Lecardane, Luca Merlini, Can Onaner, Yann Rocher, Dominique Rouillard, Marika Rupeka, Zeila Tesoriere, Xiaoli Wei.
Les manières de Viollet-Le-Duc. La forge d'une théorie de la restauration par la pratique
Auteur(s) : Bérénice Gaussuin
CNRS Paris
Architecte érudit, dessinateur exceptionnel, Eugène Viollet-le-Duc a laissé le souvenir d’un restaurateur abusif. Ce livre nous plonge dans un véritable tour de France architectural afin de dévoiler la forge de sa théorie de la restauration « sur le tas », au fil de ses chantiers sur des monuments connus (Saint-Denis, Notre-Dame de Paris) ou moins connus (Notre-Dame de Beaune, la porte Saint-André d’Autun). L’ambition du restaurateur s’avère multiple. D’abord conserver le monument dans une perspective archéologique, et opérer des ajouts créatifs dans l’esprit des bâtisseurs d’origine afin de le compléter et le maintenir en usage. Mais aussi faire renaître à travers le chantier les savoir-faire et les valeurs médiévales au cœur de ce XIXe siècle troublé.
RUINE DE L'UNIVERSEL. Communisme et nationalisme dans l'architecture du Bloc de l'Est
Auteur(s) : Georgi Stanishev
Apr 24 Metispresse
Avec Ruine de l’universel, Georgi Stanishev aborde de manière inédite le thème de la fin du projet soviétique et porte un nouveau regard sur la période de la Guerre froide. Dans le but de raconter les conflits idéologiques internes aux pays du bloc de l’Est communiste et leurs expressions architecturales, il interroge la notion d’«architecture socialiste» et déconstruit la caricature de son homogénéité. Se dévoilent ainsi la constitution et la représentation des mythes et des discours de légitimation qui ont accompagné l’affirmation d’une culture qui se voulait universelle et sa lente ruine, dans un affrontement féroce avec les nationalismes particuliers. En cherchant à lire l’évolution et la fin du projet communiste par le biais de l’architecture, l’auteur analyse de nombreux cas singuliers, des hybrides inédits entre l’utopisme survivant et le nationalisme militant. De cette approche particulière émerge l’indépassable problématique que pose encore aujourd’hui, dans notre présent post-utopique, l’identité comme principe de distinction et de reconnaissance de l’architecture. L’observation de ces imaginaires et de leur cartographie complexe contribue dès lors à révéler une nouvelle facette de la relation entre architecture et idéologie dans le contexte du 20e siècle.
Le marcheur de la gare. Une architecture des corps
Auteur(s) : Pauline Detavernier
Métispresse Genève
Comment l’espace affecte-t-il le corps ? Cette question est au coeur de la réflexion de Pauline Detavernier autour de la gare et des marcheurs qui la traversent. Il y a différentes façons de percevoir ces derniers : en voyageurs, en usagers, en habitués… mais aussi en tant qu’individus sensibles, clients potentiels ou «particules» d’un flot. Ces figures de la gare sont cumulatives et complémentaires, et s’articulent en un ballet au potentiel peu exploité. On pourrait penser que l’aménagement spatial de la structure ferroviaire facilite la marche ; or, il n’en est rien. Aujourd’hui comme au XIXe siècle, la gare est un lieu agité où le voyageur inexpérimenté se sent désorienté. Les marcheurs n’y ont pas le statut romantique du flâneur citadin ou du Wanderer dans la nature : ils sont simplement flux. En gare, la foule prévaut sur l’individu, et ce n’est pas une coïncidence si le piéton est très peu présent dans les réponses spatiales mises en avant par les concepteurs et les compagnies ferroviaires. Pourtant, le cheminement du voyageur n’est pas qu’une errance automatisée : il ruse, s’adapte, se métamorphose tout au long du parcours qui lui est destiné. À travers des récits et des redessins de gares historiques, Le marcheur de la gare propose de se réapproprier l’action de la marche pour concevoir des espaces ferroviaires plus fluides et mieux comprendre l’architecture des corps qui se joue en gare comme à bien d’autres échelles.
Sous le feu du numérique. Spatialités et énergies des data centers
Auteur(s) : Fanny Lopez et Cécile Diguet
Jul 23 Métispresse Genève
Portées par la numérisation de l’économie, par l’explosion des échanges de données, du Cloud et des objets connectés, les infrastructures numériques sont en passe de devenir l’un des plus importants postes de consommation électrique du XXIe siècle. Les data centers se multiplient en conséquence, et se déclinent en une diversité formelle surprenante: des «boîtes» anonymes standardisées, des architectures manifestes dans des campus high-tech, des bâtiments transformés tels d’anciens bureaux ou centraux téléphoniques. Visibles ou discrets, parfois même cachés dans des souterrains ou des bunkers pour échapper à la menace climatique ou terroriste, les centres de données sont omniprésents, que ce soit dans les centres-villes, dans les zones périphériques ou dans les régions rurales, reculées et désertiques. Qu’ils saturent les réseaux électriques, qu’ils soient intégrés dans des cercles d’échanges de chaleur ou d’électricité de périmètres variables – îlot, quartier, ville, territoire –, ils redéfinissent à chaque fois le projet énergétique des espaces dans lesquels ils s’implantent. À partir d’enquêtes de terrain menées à Amsterdam, Dublin, New York, Paris, Portland, Stockholm, ainsi que dans les territoires de la Silicon Valley, de l’Oregon ou du nord de la Suède, Sous le feu numérique analyse les stratégies de planification spatiales et énergétiques des data centers et appelle à questionner urgemment les limites de leur croissance incontrôlée.
Paysage de lignes. Esthétique et télécommunications
Auteur(s) : Carlotta Darò
Apr 22 Métispresse
«Je pense que dans l’avenir des fils électriques connecteront les sièges sociaux des compagnies de téléphone dans différentes villes, et qu’un homme situé n’importe où sur terre pourra communiquer par la parole avec un autre à un endroit éloigné.» En 1878, deux ans après l’invention du téléphone, Alexander Graham Bell imagine un futur de transformations radicales rendu possible par un réseau dense de fils téléphoniques: prémonition qui ne tardera pas à s’avérer. Cet ouvrage dépeint l’histoire matérielle et anonyme des objets qui composent les télécommunications modernes: poteaux électriques, fils et câbles, prises et interrupteurs, en passant par des dispositifs et micro-architectures ingénieux tels le théâtrophone et la cabine téléphonique. À partir de l’installation héroïque, vers la fin du 19e siècle, d’infrastructures couvrant la surface terrestre, traversant les sous-sols, les océans et les mers jusqu’à pénétrer les intérieurs domestiques, Paysage de lignes propose une lecture qui, par sa pluralité d'axes, explore les multiples liens et croisements que ces «choses» techniques entretiennent avec l’architecture et l’art. Enrichi d’images d’archive inédites nous révélant un imaginaire stupéfiant, cet ouvrage apporte un regard esthétique sur des objets ordinaires qui ont changé à jamais le paysage urbain, rural et domestique de notre civilisation.
A bout de flux
Auteur(s) : Fanny Lopez
Sep 22 Divergences
Le numérique a un double : l’infrastructure électrique. Le rapport immédiat aux objets connectés (smartphone, ordinateur) invisibilise le continuum infernal d’infrastructures qui se cachent derrière : data centers, câbles sous-marins, réseaux de transmission et de distribution d’électricité. Alors que le numérique accompagne une électrification massive des usages, le système électrique dépend lui-même de plus en plus du numérique pour fonctionner. Pour comprendre ce grand système et imaginer comment le transformer, il nous faut aller au bout des flux, là où se révèle la matérialité des machines et des câbles.
L'ordre électrique. Infrastructures énergétiques et territoires
Auteur(s) : Fanny Lopez
Feb 19 Métispresse Genève
La maîtrise industrielle de l’électricité et l’ordre électrique qui en est directement issu ont façonné nos sociétés depuis plus d’un siècle. Ils ont permis une démulti-plication de la croissance et de la consommation, tout en menant à l’appropriation des milieux de vie. Aujourd’hui, un mouvement de profonde reconfiguration des territoires-ressources est à l’oeuvre, remettant en question nos modes de vie ainsi que la nature et l’échelle des infrastructures et des territoires qui nous permettent de subsister, alors même qu’un grand nombre de ces derniers sont fortement dégradés. La quête d’un sol et de l’autosuffisance n’a cessé de bousculer l’ordre électrique. Cet ouvrage propose une histoire critique de ses infrastructures, depuis leur avènement à la fin du XIXe siècle, suivi par leur rapide développement à grande échelle – les monuments du capitalisme électrique –, jusqu’aux crises récentes et aux transformations qui ont conduit à l’émergence d’une diversité infrastructurelle et d’une gouvernance plus locale. Les territoires à énergie positive, les micro-réseaux électriques de Londres, de Berlin ou de New York, les mini-centrales urbaines, rurales ou domestiques, qui redessinent des trajectoires productives de plus petite échelle, promeuvent des dynamiques de réappropriation et des nouveaux systèmes d’interconnexion. Ces réalisations bouleversent les hiérarchies sociotechniques héritées du passé et redéploient nos devenirs énergétiques urbains et territoriaux.
PUBLIC. Infrastructure architecture, territoire
Paris : Beaux-Arts de Paris éditions, février 2021, 392 p.
Auteur(s) : Dominique Rouillard
Public analyse la défaite, la persistance ou la défense de ce qui liait infrastructure, bien public et identité territoriale. Il observe ce qui du public a changé ou est en train de changer touchant à la vie et à l’organisation architecturale, urbaine et territoriale à travers l’analyse de chercheurs, architectes, urbanistes, ingénieurs, historiens et sociologues. Alors que les grandes infrastructures se sont hissées depuis le 19° siècle au rang de prouesses techniques permettant de nouvelles incarnations monumentales – franchissement, traversée, captage ou transmission – on observe aujourd’hui une méfiance de la société face aux grands ouvrages techniques. Dans un renversement propre à l’ère du capitalisme néolibéral, on voit se confondre et s’opposer, d’un côté centralisation et privatisation, de l’autre, localisme ou déconcentration et bien commun. Le public se voit constamment contrebalancé, opposé, mis en péril par ce qui est devenu son quasi corolaire inversé, le privé. Au mieux il s’y associe ; plus rarement le privé retourne au public. Public, le terme sans doute le plus idéologisé de l’aménagement, est ici tenu à distance de l’expression avec laquelle il est le plus fréquemment associé – « l’espace public». Public est relevé, déplacé et réactivé en étudiant sa relation à l’infrastructure, de Bangkok à Saigon ou Guangzhou, de Trieste à Rotterdam, de l’Iran au Brésil en passant par les avant-gardes en Union soviétique. L’ouvrage analyse les diverses occurrences, dans l’histoire, le moment présent comme dans le temps fictionnel, où le terme opère dans l’environnement spatial, environnemental, politique ; public comme bien, domaine, chose, utilité, service, nécessités, investissements, patrimoine, infrastructure, espace, spectacle, ou comme invention de ses publics. Publié sous la direction scientifique de Dominique Rouillard, avec les contributions des chercheurs du Laboratoire Infrastructure, Architecture, Territoire : Sina Abedi, Marie Artuphel, Carlotta Daro, Gilles Delalex, Pauline Detavernier, Cécile Diguet, Bérénice Gaussuin, Alain Guiheux, Dimitra Kanellopoulou, Fanny Lopez, Mathieu Mercuriali, Luca Merlini, Can Onaner, Pascal Pinet, Claude Prelorenzo, Camille Reiss, Marika Rupeka, Zeila Tesoriere, Dimitri Toubanos, Xiaoli Wei.
Politique des infrastructures. Permanence, effacement, disparition
Genève : MétisPresses, février 2018, 240 p.
Auteur(s) : Dominique Rouillard (dir.)
Les infrastructures disputent à l’architecture le pouvoir politique de faire image. Elles incarnent, comme elle, la puissance d’une nation et la volonté d’en prolonger l’héritage. Cette évidence doit aujourd’hui être relativisée, tant sont vacillants les contextes dans lesquels les infrastructures sont bâties, gérées ou encore transformées. Après la crise du progrès, l’effondrement des empires coloniaux ou des totalitarismes, à l’époque de la dématérialisation des technologies et de la multiplication des risques environnementaux, la question de la durée et de la représentativité des infrastructures devient toujours plus problématique. Que dire en effet de leur résistance, de leur adaptabilité ou de leur valeur de témoignage dès lors que l’aura qu’elles étaient censées représenter s’affaiblit et que l’ancrage territorial ne constitue plus une de leurs données ? En analysant des exemples d’infrastructures produites dans plusieurs contextes politiques – la dictature militaire brésilienne, le socialisme soviétique, le colonialisme d’Indochine, ou encore la démocratie participative du « capitalocène » – cet ouvrage révèle combien leur rôle symbolique se renouvelle de manière imprévisible. Il en interroge également les destins potentiels, dans la cristallisation des imaginaires politiques à venir, entre actualisations de modèles anciens et fictions postapocalyptiques. Enfin, il se penche sur la résistance qu’opposent les infrastructures aux perpétuelles mutations de la ville contemporaine, et montre dans quelle mesure elles permettent d’assurer l’ajustement entre le réel et les imaginaires qui traversent l’espace urbain.
Le XIQ, dits et dessins d’architecture
Paris: Métispresses, novembre 2017, 224 pages.
Auteur(s) : Luca Merlini
Il y a quelques années, Luca Merlini proposait de traverser Le Pays des maisons longues (2010). Ce précédent voyage en architecture en six étapes trouve une suite ici : elle se passe dans un lexique en compagnie d’inconnues (X), d’invités (I) et de quasi-fictions (Q). Cela donne le XIQ, rencontre encore dits et dessins d’architecture. Comme dans tout lexique, c’est l’occasion d’une lecture-parcours sans ordre prédéfini : à chacun d’y dessiner sa trajectoire selon son désir. On peut y passer, volontairement ou subrepticement, d’un concept à un personnage, d’un mur sans fin à un photoroman, d’un immeuble-littéraire aux mains de Grünewald, de lumière à digital… Ce vagabondage est une invitation à devenir un habitant du XIQ, c’est-à-dire un habitant de la pensée dessinée de l’architecture. Avec une préface de Bernard Tschumi.
La tour Tatline. Monument à la IIIe Internationale?
Paris: B2, collection Laboratoires, octobre 2017, 176 pages, 77 ill. Introduction de Nikola Jankovic.
Auteur(s) : Georgi Stanishev
Avec sa silhouette iconique de Babel des Temps modernes, on croit toujours se « souvenir » du Monument à la IIIe Internationale (1919-1920) de V. Tatline (1885-1953). Pourtant, notre esprit ne retient souvent de la « Tour Tatline » que la sculpture tirée d’un musée imaginaire, alors qu’il s’agit d’abord du modèle réduit d’une « anti-Tour Eiffel » non réalisée. Bien plus élevée que les 160 m du treillis fuselé de la Tour TSF (1920-1922) de l’ingénieur-architecte V. Choukhov (1853-1939), les 400 m de contreplongées constructivistes auraient dû incarner un monument socialiste et une œuvre d’art cosmopolite totale, tour à tour promenade cinématique, centre d’émission radio et haut-parleur d’amplification de la voix de Moscou : à la ville et au monde prolétarien.
Le grand espace commun. L’architecture transforme
Métispresses, avril 2017.
Auteur(s) : Alain Guiheux
« Les titres du journal Libération deviennent vite des projets d’architecture. Cette nouvelle situation n’est plus disciplinaire, elle capte tout ce qui vient d’ailleurs: la réponse de l’architecture aux sollicitations des tendances est immédiate. » Une capacité accélérée d’importer la nébuleuse imaginaire de l’instant, voici l’efficacité de l’architecture. C’est à elle de rendre possibles toutes les histoires que les humains se racontent, tous les désirs et toutes les tentations. Les dispositifs architecturaux travaillent les repré-sentations et les comportements, et réalisent ainsi la performance de l’architecture dans sa capacité à nous transformer. Architecte et théoricien, Alain Guiheux explore le déploiement de cette extension de l’univers ouvert de l’architecture au sein de l’ensemble des objets fabriqués et communicants. Au travers d’un parcours en six chapitres dans le mouvement des histoires, des évènements et des images, l’auteur nous conduit à en repenser quelques thèmes majeurs – l’urbanisme comme récit, le projet réflexif, le point de vue de l’expérience et de l’émotion, le patrimoine de l’instant, les scènes architecturale et cinématographique, la transluscence comme valeur. Et pourtant, il serait erroné d’en conclure à la dissolution de l’architecture: car c’est au final à l’architecture de conditionner la production même d’imaginaires et, plus radicalement, de transformer nos paradigmes. C’est en suivant les traces d’une quête qui, siècle après siècle, nous conduit au Grand espace commun, vers un dépassement émancipateur de toutes les différenciations binaires, qu’Alain Guiheux signe un livre engagé et confiant.
L’enseignement de la transition écologique dans les ENSA (1 : État de l’art, 2 : Actes du séminaire), publication des livrables issus du séminaire pédagogique inter-écoles sur l’enseignement de la transition écologique dans les ENSA du 26 nov. 2015 à l’ENSA Paris-Belleville
2016.
Auteur(s) : Philippe Villien et Dimitri Toubanos (dir.)
Aldo Rossi, architecte du suspens, en quête du temps propre de l’architecture
MétisPresses, 2016.
Auteur(s) : Can Onaner
« Pour Aldo Rossi l’architecture se déploie comme un rite: les signes architecturaux qui se répètent, les différents types qui sont repris d’un projet à l’autre, reproduisent la corporalité qui est à leur origine. Dans ce rituel, le monde des sensations et des impulsions obscures que la rationalité moderne avait rejeté refont surface de manière inattendue. À travers l’identification de l’architecture au corps animal ou humain, le désir qui était mis à l’écart de toute création est réintroduit dans l’architecture. Il s’agit d’un désir latent, inquiet de sa propre mort, un désir qui ne saurait s’exprimer autrement qu’à travers la répétition d’une typologie architecturale invariable. Parler de suspens en architecture revient ainsi, dans un premier temps, à évoquer un état de figement dont la finalité serait d’accéder à une temporalité anhistorique où la fixité domine. Toutefois, parler de suspens c’est aussi suggérer qu’il existe une attente et une latence au sein de cette fixité. C’est dire que le temps du suspens est corporel et inquiet. » Nous entraînant dans une enquête subtile qui traverse les écrits, projets et dessins réalisés entre 1959 et 1982 par l’architecte italien, l’ouvrage de Can Onaner permet de dévoiler sous un jour nouveau les notions et thèmes fondamentaux de l’œuvre d’Aldo Rossi: le type, la répétition, la permanence. Mais aussi de fonder le concept de suspens comme une nouvelle approche théorique de l’architecture, emblème de tout projet architectural inquiet de sa pérennité et mythe nécessaire, sinon fondateur, de toute urbanité.
Obsolescences et Régénérescences Aéroportuaires en Amérique Latine
Presses Académiques Francophones, 2016
Auteur(s) : Emile Duhart
L’infrastructure aéroportuaire est devenue, en ce début de XXI siècle, le pivot des croisements de flux de personnes et de marchandises dans notre monde « globalisé », elle apparaît même comme le monument icône de la métapole. L’évolution constante et particulièrement rapide de cette infrastructure, depuis le transport aérien de masse, nous questionne sur l’objet "aéroport", à travers ses caractéristiques urbaines, architecturales et de design, en relation à sa ville d’accueil et à son devenir dans le futur. L’un des aspects significatif de la relation ville et aéroport est la confrontation territoriale entre ces deux entités : Elle peut mener dans certains contextes à l’obsolescence de la plateforme aéroportuaire face à l’expansion urbaine chaotique et au refus de l’infrastructure par les riverains. Ce livre explore les phénomènes d'obsolescences et de régénérations aéroportuaires dans le cadre de l'Amérique Latine. Il s’interroge sur la question de la croissance dans notre monde aux limites finies, constate que certains exemples d’aéroports, en Amérique Latine, donnent par leur echelle une réponse positive au problème et tendent en même temps à conjurer leur obsolescence.
Afriques. Architectures, infrastructures et territoires en devenir
ENSAPM, éd. Beaux-Arts de Paris, 2015
Auteur(s) : Dominique Rouillard (dir.)
Le Laboratoire Infrastructure Architecture Territoire conduit une exploration sur des pratiques spatialisées en Afrique, et interroge la mutation des infrastructures et leur rôle dans l'organisation des territoires urbains et périurbains, mettant en évidence le nouveau contexte des enjeux environnementaux qui viennent à concerner son continent. Si les infrastructures sont perçues comme une clé majeure de son développement, elles le sont tout autant pour réaliser son unité géographique, politique et culturelle : l'Afrique "a besoin de se relier à elle-même".
Door to door. Futur du véhicule, futur urbain // Version anglaise : Door-to-door. Future of the Vehicle, Future of the City
Archibooks, 2015
Auteur(s) : Dominique Rouillard, Alain Guiheux
Electric/environmentally friendly vehicles that are equipped with embedded digital communication, in the era of intelligent flows and the Internet of Things, are transforming contemporary architecture and the city. Door-to-door, Future of the Vehicle, Future of the City rethinks urban situations, theorizes and imagines future development models and the new architectural programs that stem from them. It proposes and presents "access spaces", the extension-multiplication of "door-to-door" accessibility in six European metropolises and the repair function of these new tools of connected "auto-mobility", solving urban dysfunctions through their use. The parking facility becomes a program of the future for architecture, while the Electric/Environmentally friendly Connected Vehicle (ECV), a tool soon to be automated, neither noisy nor dirty, moves alongside humans, nature and animals in buildings - the sharing of presences and activities in a "large common space".
Les murs du son, le Poème électronique au Pavillon Philips
Editions B2, 2015
Auteur(s) : Carlotta Darò
Architecture et écologie. Comment partager le monde habité?
Editions Eyrolles, (seconde édition augmentée) 2015.
Auteur(s) : Grégoire Bignier
Narrations touristiques et fabrique des territoires. Quand tourisme, loisirs et consommation réécrivent la ville
Paris, éd. L’œil d’or, 2015
Auteur(s) : N. Fabry, B. Pradel, V. Picon-Lefebvre
Hommage à la résonance et matérialisation acousmatique: Carlotta Darò en conversation avec Pascal Broccolichi
Seconde-lumière, catalogue de l’exposition présentée à la Maréchalerie-centre d’art contemporain de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles du 8 avril au 4 juillet 2015.
The Dialogic City. Berlin wird Berlin
Cologne, Walther König Verlag, 2015
Auteur(s) : F. Hertwech, A. Brandlhuber (dir.)
Paesaggio/Paesaggi. Vedere le cose
Libria, Melfi, 2015
Auteur(s) : Marco Assennato
Les architectes et la construction
Réédition complétée et révisée, Parenthèses, 2014
Auteur(s) : V. Picon-Lefebvre, C. Simonnet
L’archipel Tschumi, cinq îles
Paris, éditions B2, 2014
Auteur(s) : L. Merlini, préface de C. Parent
De l’idée à la matière, exercice pédagogique de l’ENSA Paris-Malaquais / suivi de chantier
Paris, ENSAPM, 2014
Auteur(s) : M. Salerno, R. Le Roy, J. Léonard, et L. Merlini (dir.)
Le rêve d'une déconnexion
Editions de la Villette, 2014
Auteur(s) : Fanny Lopez
Pensare l'Europa
Editions Mimesis, Milan, 2014
Auteur(s) : Marco Assenato (dir.)
Avant-gardes sonores en architecture
Dijon, Les Presses du réel, 2013
Auteur(s) : Carlotta Darò
The City in the City. Berlin : A Green Archipelago. A Manifest by O. M. Ungers, R. Koolhaas, P. Riemann, H. Kolhoff and A. Ovaska
Edition critique, Lars Muller, 2013
Auteur(s) : Sébastien Marot, Florian Hertweck (dir.)
Urbanism after Urbanism. VIIth U&U International PhD seminar
LIAT, 2013
Auteur(s) : D. Rouillard, J. Wlaszyn, G. Stanishev (dir.)
Eileen Gray, l'Etoile de mer, Le Corbusier. Trois aventures en Méditerranée
Archibooks, 2013
Auteur(s) : Claude Prelorenzo (dir.)
Climats. Conférences de Paris-Malaquais II
sous la direction de Thierry Mandoul, Jac Fol, Florian Hertweck, et Virginie Picon-Lefebvre, éd. In Folio, 2013
La Défense: un dictionnaire architecture / politique et un atlas histoire / territoire
Sous la direction de Virginie Picon-Lefebvre et Pierre Chabard Parenthèses, 2013
Architecture et écologie. Comment partager le monde habité ?
Grégoire Bignier, éd. Eyrolles, 2012
L’infraville. Futurs des infrastructures
sous la directions de D. Rouillard, Paris, Archibooks, 2011
Der Berliner Architekturstreit
Florian Hertweck, Gebr. Mann Verlag, 2010.
Le pays des maisons longues et autres trajectoires
Luca Merlini, éd. MétisPresses, 2010
Imaginaires d'infrastructure
Dominique Rouillard (dir.), éd. L'Harmattan, 2009
Les infrastructures inscrivent sur le territoire des imaginaires réalisés de la ville, de la mobilité et des transports, un système de communication symbolique aussi puissant que les infrastructures matérielles. Cette dimension peu souvent approchée des infrastructures est investie par cet ouvrage. La culture mythologique, fictionnelle ou fantasmatique des infrastructures s'explore dans l'analyse des productions filmiques et discursives, et dans les pratiques et expériences de la route que développe et exporte "en masse" la culture américaine d'après-guerre. La puissance de l'imaginaire infrastructurel se révèle dans ce qui lie l'infrastructure aux récits du futur, futurs des villes ou de l'architecture. Il n'y a alors pas de futur sans infrastructure. Approchées dans toutes les échelles de ses perceptions, passant de l'oeil à fouie avec les infrastructures sonores, du monument unique au réseau mondial des flagship, du symbole du progrès à un outil de communication de la société post-industrielle, de la présence dure et durable à la flexibilité, au détournement ou à l'adaptation, les infrastructures dessinent le paysage multicouche de notre environnement bâti, sensoriel et spectaculaire. Claude Prelorenzo, Marie Bernard, Caroline Maniaque, Dominique Rouillard, Florian Hertweck, Gilles Delalex, Nathalie Roseau, Fanny Lopez, Eric Alonzo, Virginie Lefèbvre, Renzo Lecardane, Corinne Jaquand, Maria Salerno, Carlotta Daro.
La métropole des infrastructures
Claude Prelorenzo, Dominique Rouillard (dir.), éd. Picard, 2009
Le temps des infrastructures
Claude Prelorenzo, Dominique Rouillard, éd. L'Harmattan, 2007
Go with the flow : architecture, infrastructure and the everyday experience of mobility
Gilles Delalex, University of Art and Design Helsinki, 2006
Architectures contemporaines et monuments historiques. Guide des réalisations en France depuis 1980
Dominique Rouillard, éd. Le Moniteur, 2006
Ce livre scelle la rencontre de deux cultures - la conservation et la création - qui agissent l'une sur l'autre malgré l'extrême sectorisation des pratiques : des deux côtés se relaient des concepteurs qui oeuvrent à la mémoire des monuments en leur assurant un devenir. L'acte de conserver un monument historique relève autant de la création que le projet d'architecture qui, lui, est inéluctablement voué à se positionner en fonction de l'existant. Loin des propos convenus, l'auteur, Dominique Rouillard, reformule la question du rapport entre la conservation et la création en la confrontant à l'histoire de l'architecture mondiale. Outre l'essai théorique, riche d'illustrations parfois surprenantes, le livre offre une seconde section : un guide qui répertorie les monuments historiques de France ayant fait l'objet d'une intervention contemporaine depuis 1980.
Superarchitecture – le futur de l’architecture 1950-1970
Dominique Rouillard, éd. de La Villette, 2004
Paris-ville moderne. Maine-Montparnasse et Le Défense, 1950-1975
Virginie Lefèbvre, éd. Norma, 2003
Echelles et dimensions. Ville, Architecture, Territoire
Claude Prelorenzo, Dominique Rouillard (dir.), éd. L'Harmattan, 2003
Les savoirs sur les infrastructures modernes de transport, routes, voies ferrées, ports... et sur l'aménagement territorial de grande dimension, sont aujourd'hui peu nombreux et mal diffusés. Cet ouvrage se propose donc d'éclairer un terrain et des questionnements qui, faute du concours de la science, resteraient peu compréhensibles, et de ce fait facilement vilipendés au nom de nostalgies passéistes de divers types. Il interroge les conditions théoriques et pratiques de la production des infrastructures et de l'aménagement du territoire au travers de plusieurs approches qui mettent en jeu le concept d'échelle et la notion de dimension. Gilles Delalex, Gwenael Delhumeau, Georges Farhat, Caroline Maniaque, Antoine Picon, Virginie Lefèbvre, Phan Nguyen Hoang Nguyen, Philippe Potié, Claude Prelorenzo, Rachel Rodrigues Malta, Dominique Rouillard, Cyrille Simonnet.
Mobilité et esthétique. Deux dimensions des infrastructures territoriales
Claude Prelorenzo, Dominique Rouillard (dir.), éd. L'Harmattan, 2001
Infrastructures. Villes et Territoires
Claude Prelorenzo (dir.), éd. L'Harmattan, 2000
L'aventure du balnéaire. La grande motte de Jean Balladur
Claude Prelorenzo, Antoine Picon, éd. Parenthèses, 1999
Nice : une histoire urbaine
Claude Prelorenzo, éd. Hartmann, 1999
Le site balnéaire
Dominique Rouillard, éd. Mardaga, Bruxelles, 1984.
Construire la pente. Los Angeles 1920-1960
Dominique Rouillard, éd. In Extenso, Paris, 1984. // Version anglaise : Building the slope. Hillside houses in Los Angeles, Arts + Architecture Press, Santa Monica, USA, 1987. Réédition en 1999 chez Hennessy and Ingalls.